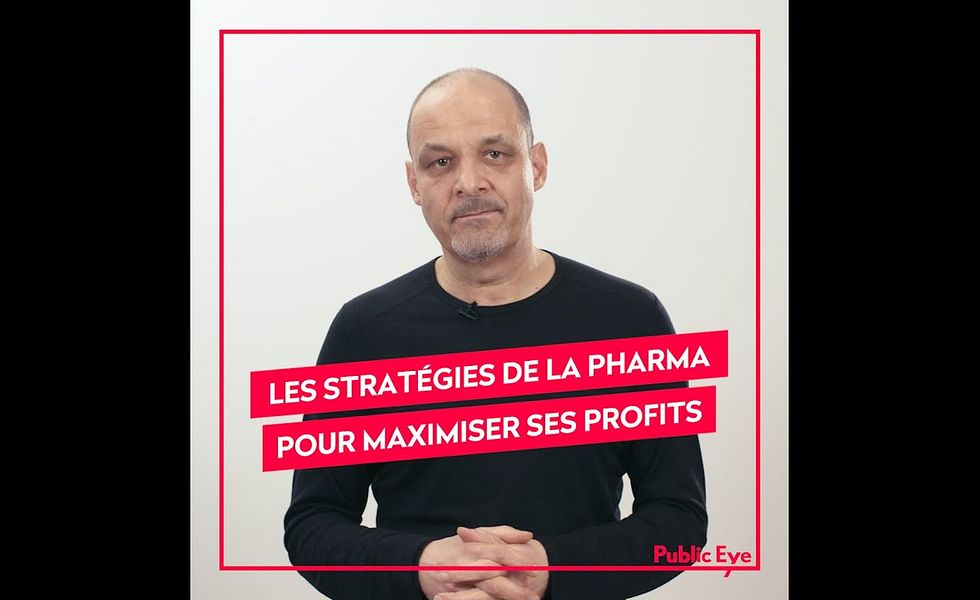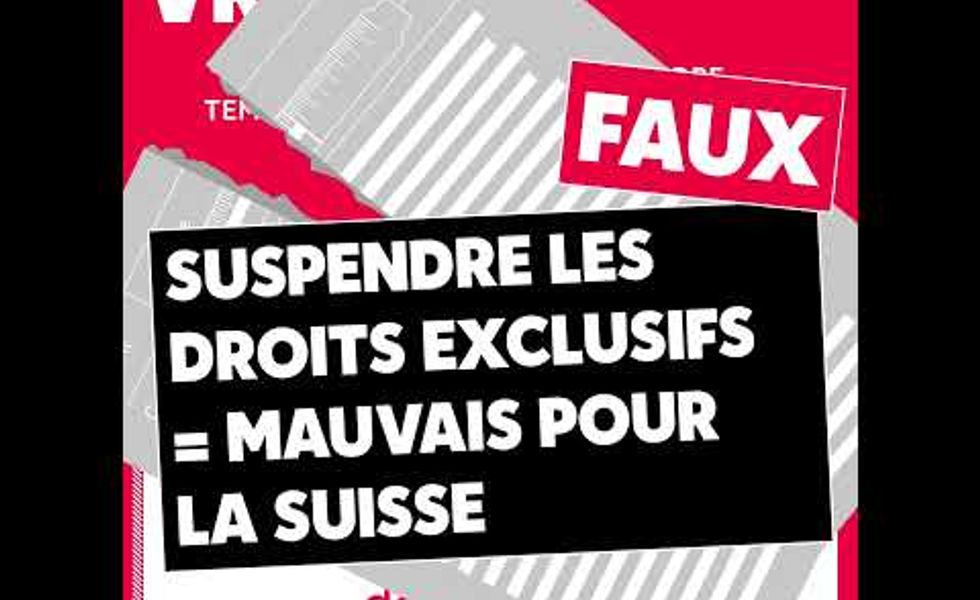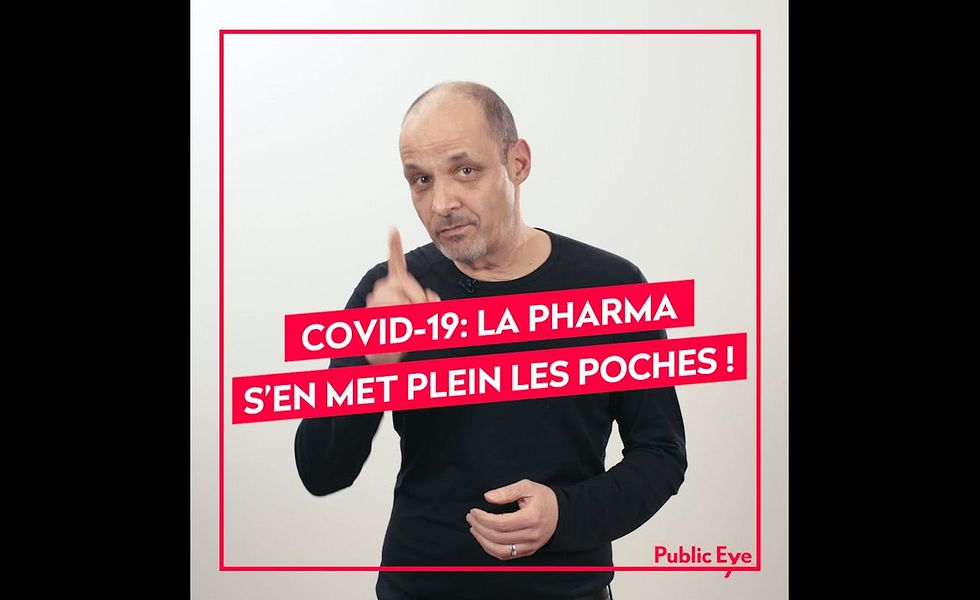Covid-19: le profit à tout prix
En 2009, lors de la crise du H1N1 (ou grippe porcine), on assistait déjà à une véritable course aux vaccins sur fond de capacités de production qui, selon les projections, étaient insuffisantes pour couvrir l’ensemble des besoins au niveau mondial. La Suisse et d’autres États riches passaient en 2009 des pré-commandes auprès de producteurs de vaccins contre le H1N1, dont Novartis, alors que ceux-ci n’étaient même pas encore homologués. Pour la Suisse: 13 millions de doses destinées à couvrir 80% de la population, pour un coût total de 84 millions de francs. Il s’agissait de pouvoir couvrir ses propres besoins nationaux face à une pénurie programmée. Alors que le chacun pour soi régnait en maître, les pays du Sud et de l’Est n’ont eu que des miettes, voire rien du tout.
La question de la préférence nationale reste plus que jamais d’actualité, et elle s’est même renforcée au fur et à mesure du lancement, en quantités inévitablement limitées, de traitements ou vaccins contre le Covid-19.
Les belles paroles des sociétés pharmaceutiques et des pays riches (comme la Suisse) qui les hébergent, qui affirmaient que tout était différent cette fois-ci, compte tenu de l’ampleur et de l’urgence de la pandémie, se sont vite avérées hypocrites.
Ainsi, en mai 2020 déjà, l’Assemblée mondiale de la santé, composée des 194 États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a adopté la résolution WHA73.1 demandant un «accès universel, rapide et équitable de tous les produits et technologies de santé nécessaires à la riposte contre la pandémie de Covid-19, ainsi que leur juste distribution». Mais ce texte a été considérablement édulcoré au fil des négociations, notamment à l’initiative de la Suisse qui a tenté de faire biffer la notion de «biens publics», sans succès. La Suisse s’est aussi distinguée en 2021 en tentant d’affaiblir massivement une autre résolution de l’OMS visant à favoriser l’accès au savoir-faire pharmaceutique et aux droits de fabrication pour une production décentralisée en Afrique.
Le Covid-19 a eu de lourdes conséquences sur la santé, la subsistance et la vie sociale partout dans le monde. Il a touché de plein fouet les populations les plus vulnérables, dans le monde entier et en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Les mesures nationales ne sont pas de taille pour lutter contre une pandémie; les efforts doivent être coordonnés entre les pays. L'accès inéquitable aux vaccins, diagnostics et traitements du Covid-19 a eu – et continue à avoir – des conséquences dévastatrices, en particulier dans les pays moins favorisés.
Voici un aperçu de nos revendications et actions tout au long de la pandémie, appelant à une Suisse solidaire et à un accès équitable aux moyens de lutte contre le Covid-19 partout dans le monde.
Plus d'informations
-
1) Mutualiser les moyens de lutte contre le Covid-19 (WHO pool)
Dès mars 2020, Public Eye et ses alliés ont soutenu l’appel du Costa Rica à la mise en place d’un mécanisme de mutualisation des droits, données, savoir-faire et autres procédés de fabrication sur toutes les technologies médicales nécessaires à la prévention, à la détection et au traitement du Covid-19 au niveau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Un tel mécanisme permettrait de garantir l’accès aux tests diagnostiques, médicaments, vaccins et autres équipements nécessaires à la lutte contre le coronavirus au niveau mondial, et en assurer une répartition équitable. Ce «pool» a été officiellement lancé fin mai 2020 sous l’appellation C-TAP (pour «Covid-19 Technology Access Pool»), mais il n’a reçu aucun soutien des entreprises pharmaceutiques, ni des États qui les hébergent comme la Suisse.
Public Eye a également interpellé à plusieurs reprises le Conseil fédéral, par le biais de lettres ouvertes ou via une pétition commune avec Amnesty Suisse soutenue par plus de 20'000 personnes, afin que la Suisse adhère à ce programme de partage des connaissances C-TAP et qu’elle incite les entreprises pharmaceutiques domiciliées en Suisse à y adhérer. Deux interpellations ont également été déposées sur ces sujets lors de la session extraordinaire du Parlement en mai 2020.
Toutes ces initiatives ont été vaines puisque la Suisse n’a jamais adhéré, ni même soutenu l’initiative C-TAP de l’OMS. Nos autorités n’en voyaient pas l’utilité, accordant une confiance aveugle aux engagements volontaires pris par les pharmas, et prétextant un manque de «praticabilité des démarches proposées (par ex. les contrats de licence globaux)». En résumé: la Suisse s’est montrée très peu solidaire et une fois encore extrêmement craintive face aux réactions négatives de ses entreprises pharmaceutiques dès lors qu’on touche aux sacro-saints droits exclusifs qui font leur beurre. Le fait que nos courriers au Conseil fédéral soient longtemps restés sans réponse a témoigné d’un embarras certain de la part de nos autorités, comme à chaque fois qu’il est question de propriété intellectuelle et d’accès aux médicaments.
-
2) COVAX, une initiative vouée à l’échec
En lieu et place du pool C-TAP, la Suisse a préféré soutenir l’initiative baptisée ACT-Accelerator, qui comprend le mécanisme de partage international des vaccins appelé COVAX, car elle offrait l’avantage – pour les pays riches hébergeant des géants pharmaceutiques – de ne pas remettre en cause la propriété intellectuelle. C’est pourtant précisément cette dernière qui a empêché le partage des connaissances et la démultiplication rapide des sites de production de biens médicaux urgents. COVAX, qui a dû lutter pour obtenir ses propres doses du fait d’une production limitée et de la multiplication d’accords passés directement entre les pays aisés et les producteurs de vaccins, a donc dû sérieusement revoir ses objectifs à la baisse. Une évaluation externe de l’initiative ACT-A menée en 2022 a conclu qu’un «modèle différent était nécessaire dans une réponse globale à une pandémie et que l’initiative ne devrait pas être répétée à l’avenir», et que la question du manque de partage des technologies et de production décentralisée ont été les facteurs-clés du bilan plus que mitigé de l’initiative.
Public Eye n’a pourtant cessé de répéter qu’il fallait une solution au problème de la propriété intellectuelle, au travers de tribunes dans la presse ou dans ses publications. Mais les autorités suisses ont préféré faire la sourde oreille, continuant à privilégier les profits de l’industrie pharmaceutique au détriment d’un accès équitable aux moyens de lutte contre le Covid-19.
-
3) Déroger aux règles de l’OMC («TRIPS Waiver»)
Face à la pénurie programmée et au manque de soutien au pool C-TAP, l’Inde et l’Afrique du Sud ont déposé, en octobre 2020, une demande de dérogation temporaire de l’accord sur les droits de propriété intellectuelle (ADPIC) pour les produits de lutte contre le Covid-19, comme le prévoient les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) lors de situations exceptionnelles.
Si la dérogation ADPIC («TRIPS Waiver» en anglais) était acceptée, chaque État membre de l’OMC pourrait décider de ne pas tenir compte de la propriété intellectuelle pour les moyens de lutte tant que durera la pandémie. En clair: une firme locale disposant du savoir-faire nécessaire serait autorisée à produire des tests, traitements ou vaccins sans avoir à négocier longuement (parfois en vain) une licence.
Les pays hébergeant les géants pharmaceutiques, dont la Suisse, n’ont cessé de s’opposer à la dérogation ADPIC, prétextant que les brevets n’ont pas été un obstacle durant cette crise. C’est faux, et de nombreux brevets ont été octroyés, notamment pour les vaccins Covid-19 (Moderna et Pfizer sont d’ailleurs en plein litige judiciaire).
Les opposants ont mis en avant des mécanismes existants, comme les licences volontaires ou obligatoires. Or les premières, lorsqu’elles sont octroyées par la pharma, sont exclusives et restreintes géographiquement. Quant à la procédure de licence obligatoire – un Etat autorise la commercialisation de génériques malgré le brevet pour faire valoir l’intérêt public – elle varie selon les législations nationales, ne concerne qu’un seul produit dans un marché spécifique et donne lieu à de fortes pressions diplomatiques sur les pays souhaitant l’actionner.
Une dérogation ADPIC aurait permis d’éviter tous ces obstacles. Public Eye et d’autres ONG ont donc interpellé à plusieurs reprises le gouvernement suisse par des lettres ouvertes, par une pétition ou par d’autres interventions publiques afin qu’il cesse de bloquer la dérogation soutenue par une centaine de pays, par l’OMS, ainsi que par de nombreuses organisations internationales et personnalités.
-
4) Big Pharma: le profit à tout prix

La pandémie a consacré le modèle d’affaires de l’industrie pharmaceutique, qui lui permet de réaliser des gains colossaux au détriment de l’intérêt public. Un rapport inédit de Public Eye décortique les dix méthodes utilisées par Pfizer, Roche ou Novartis pour exploiter de manière systématique la crise du coronavirus à leur avantage. Il montre aussi comment la complicité de la Suisse et d’autres pays riches a conduit à la pénurie et à une répartition inéquitable des vaccins, traitements et tests diagnostiques contre le Covid-19.
Dans le rapport «Big Pharma takes it all», Public Eye a analysé les stratégies des géants de la pharma pour maximiser leurs bénéfices et la manière dont ils tirent profit de la crise, alors même que leurs produits ont été massivement financés par des fonds publics. Les pays riches, comme la Suisse, protègent les intérêts de leur industrie pharmaceutique, en entravant les efforts déployés à l’international en faveur d’un accès équitable aux vaccins, tests et traitements contre le Covid-19. Or la santé est un droit humain que les États ont le devoir de protéger. S’il n’est pas garanti, ils doivent intervenir.
L’argument mis en avant par la pharma et la Suisse selon lequel les droits exclusifs doivent servir à recouvrer l’investissement initial grâce au monopole qu’ils octroient ne tient pas en temps de crise. Car si l’effort de recherche a été aussi intense, c’est surtout grâce aux subventions publiques colossales investies, sans lesquelles l’industrie pharmaceutique n’aurait jamais pu mettre au point un vaccin en si peu de temps. Ces contributions ont écarté le risque en matière de recherche et développement (R&D) souvent mis en avant pour justifier les monopoles et des prix élevés, ce d’autant plus qu’elles ont été octroyées sans conditions contraignantes. Les accords de réservation passés avec les pays aisés – avant même que le produit ne soit commercialisé – leur ont en outre garanti d’écouler leur production, à un prix qui a largement rentabilisé leurs propres investissements. Ainsi, selon un rapport de SOMO de février 2023, les firmes Pfizer, BioNTech et Moderna ont enregistré un profit net cumulé de 75 milliards de dollars entre 2021 et 2022 pour leurs vaccins et traitements anti-Covid.
-
5) La Suisse a commandé beaucoup trop de vaccins
Les appels initiaux à la solidarité internationale ont très vite cédé la place à un égoïsme national. Alors qu’au printemps 2020 elles considéraient ceux-ci comme «un bien public mondial accessible partout dans le monde», les grandes puissances – États-Unis et Europe en tête – ont commandé des doses à tour de bras pour leurs propres besoins, avant même qu’elles ne soient homologuées et sans se préoccuper de savoir s’il en restera pour les autres.
La Suisse n’était pas en reste et a aussi passé commande dès le début du mois d’août 2020, suivie de beaucoup d’autres. En tout, de 2020 à 2023, la Suisse a commandé plus de 65 millions de doses de vaccins Covid-19 pour au moins 1,5 milliard de francs, soit de quoi vacciner plus de sept fois chaque citoyen·ne! En 2022, elle a déjà dû détruire quelque 9 millions de doses, et beaucoup d’autres arriveront à péremption en 2023. Un véritable gâchis.
La Suisse a bien tenté de céder des doses à des pays qui en auraient eu besoin, notamment via le mécanisme COVAX, mais le processus est compliqué sachant que l’industrie pharmaceutique possède un droit de véto, et la demande a baissé du fait de la situation épidémiologique. Les gouvernements ont été pris en otage, mais avec leur propre consentement.
Impossible aussi de connaître les modalités contractuelles et le montant précis dépensé pour toutes ces commandes, bien qu’elles aient été payées par le contribuable. Toutes les tentatives d’accéder aux contrats via la loi sur la transparence ont été systématiquement refusées, sous le prétexte de «secrets d’affaires». Les contrats passés entre un pays et les producteurs sont saturés de clauses de confidentialité et garantissent «le dernier mot» aux entreprises de la pharma.
-
6) Un traité contraignant pour mieux gérer les prochaines pandémies
Si l’idée d’un traité pandémie n’est pas nouvelle, l’Assemblée mondiale de la santé a décidé de la concrétiser formellement lors de sa session spéciale de novembre 2021, en réponse à un «échec catastrophique de la communauté internationale à faire preuve de solidarité et d’équité dans sa réponse à la pandémie de coronavirus». Elle a également décidé de réactualiser le règlement sanitaire international (RSI), un instrument en vigueur depuis 2005, dont l’objectif principal est la prévention et la lutte contre la propagation mondiale de maladies infectieuses. Il y a donc deux chantiers parallèles en cours à l’OMS.
Alors que les résolutions de l’OMS ne sont que des recommandations, que les États peuvent suivre ou non, un traité (ou une convention reposant sur l’article 19 de sa Constitution) est un instrument avec des règles contraignantes qui obligent les États l’ayant signé et ratifié. Il n’existe à ce jour qu’une seule convention de ce type à l’OMS, la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, en vigueur depuis 2005.
Un organe intergouvernemental de négociation (Intergovernmental Negotiating Body, INB) représentant toutes les régions du monde a été établi pour proposer et négocier un texte de traité. Après plus d’un an de travaux préparatoires, l’INB a publié une première ébauche intitulée «Zero draft» en février 2023. Celle-ci constituait une première base de travail intéressante, puisqu’elle reprenait les principaux problèmes rencontrés durant la pandémie de Covid-19: levée temporaire des droits de propriété intellectuelle (Waiver), partage du savoir pour une production décentralisée, contreparties aux financements publics, allocation (réserve) de moyens de lutte au niveau de l’OMS.Le calendrier de négociation est extrêmement ambitieux puisqu’il prévoit l’adoption d’un traité pandémie lors de l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2024. Il est aussi semé d’embûches puisque le lobby de la pharma, farouchement opposé à toute dérogation en matière de propriété intellectuelle, n’a de loin pas encore dit son dernier mot, et que les mêmes réflexes protectionnistes et nationalistes des pays riches rencontrés durant la pandémie de Covid-19 sont déjà à l’œuvre pour édulcorer le texte – quitte à le rendre inefficace.
Si la Suisse a soutenu la décision de négocier un traité pandémie, il reste à voir si elle jouera le jeu de la solidarité et de l’équité jusqu’au bout. L’avenir le dira, et Public Eye veillera à lui rappeler ses obligations internationales chaque fois qu’il le faudra.