Pesticides interdits Les exportations de l’UE en forte hausse malgré les promesses de la Commission
Laurent Gaberell, 23 septembre 2025
En octobre 2020, la Commission européenne promettait de «montrer l'exemple» et de mettre fin à l’exportation de pesticides interdits dans l’Union européenne (UE), dans le cadre d'une nouvelle stratégie sur les produits chimiques présentée comme un pilier du «Pacte Vert». Cet engagement était pris dans le sillage d’une enquête de Public Eye et Unearthed, la cellule investigation de Greenpeace Royaume-Uni, qui avait pour la première fois mis en lumière l’ampleur du scandale des pesticides interdits «made in Europe».
 ©
Shutterstock
©
Shutterstock
« L'UE ne serait pas cohérente dans son ambition d'un environnement sans produits toxiques si des produits chimiques dangereux dont l'utilisation n'est pas autorisée dans l'UE pouvaient encore y être produits puis exportés », renchérissait Virginijus Sinkevičius, alors commissaire européen à l’environnement, lors du lancement d’une consultation publique en lien avec cette initiative en 2023. Alors que plusieurs États membres commençaient à serrer la vis au niveau national, la Commission jugeait par ailleurs « essentielle » l’adoption d’une approche uniforme à l’échelle européenne afin de « garantir l'harmonisation et la clarté des règles ».
Pourtant, des nouvelles données exclusives obtenues par Public Eye et Unearthed montrent que malgré les engagements de la Commission européenne, les exportations de pesticides interdits n’ont cessé d’augmenter. En 2024, les pays membres de l’UE ont approuvé l’exportation de près de 122'000 tonnes de pesticides dont l’utilisation est bannie sur leurs propres sols en raison de risques inacceptables pour la santé ou l’environnement. Soit une hausse de 50% par rapport aux quelque 81'000 tonnes annoncées en 2018. Ajustées en fonction du Brexit – le Royaume-Uni était alors le principal exportateur, responsable à lui seul de 40% des volumes – les exportations de l'UE ont plus que doublé en six ans.
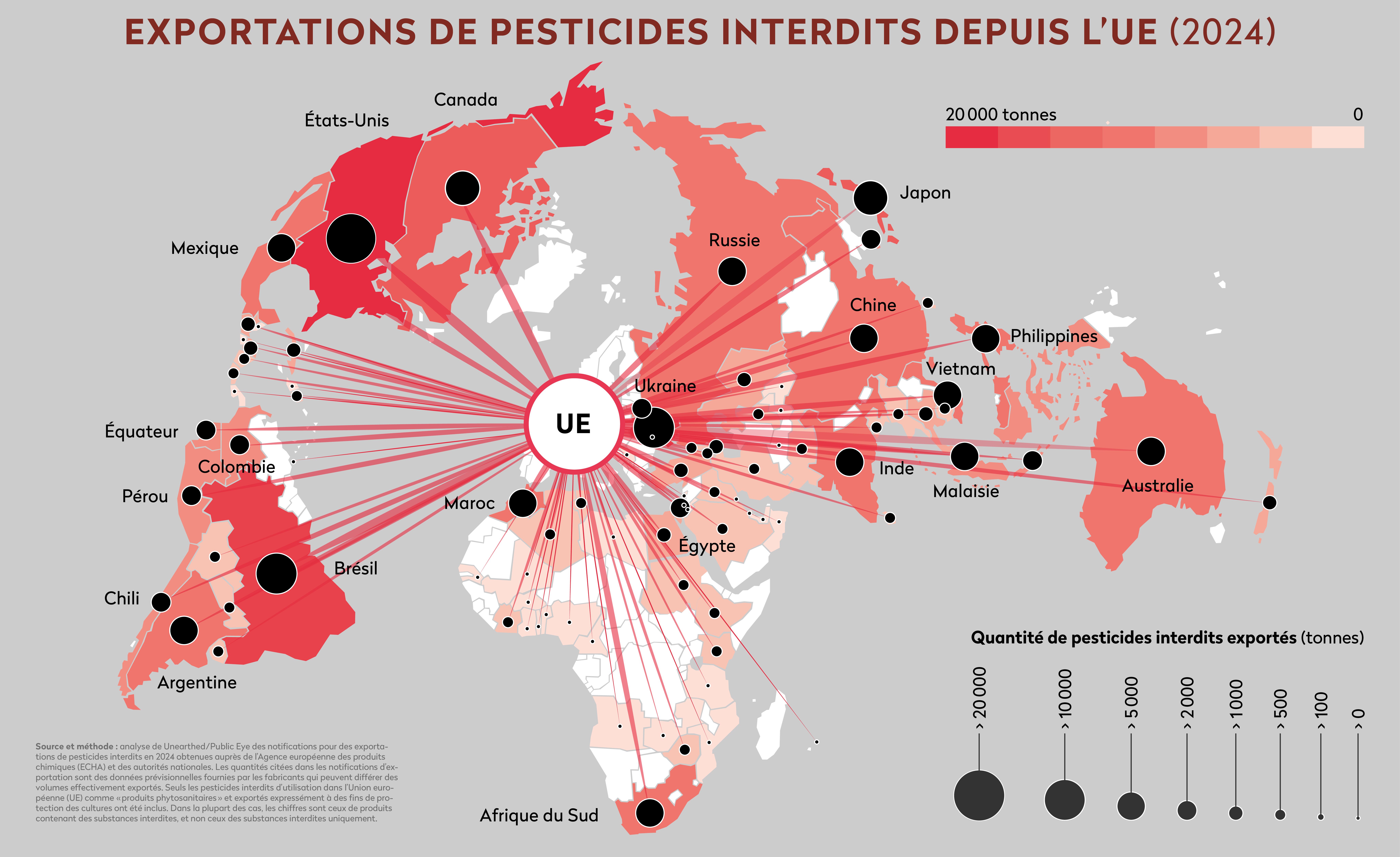 ©
opak.cc
©
opak.cc
Ces nouvelles révélations se basent sur l’analyse de centaines de « notifications d’exportation » – les documents que les entreprises doivent remplir lorsqu’elles veulent exporter des produits chimiques dangereux interdits dans l’UE vers des pays tiers. Public Eye et Unearthed les ont obtenus en vertu du droit à l’information auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et des autorités nationales. Bien que les quantités mentionnées soient des données prévisionnelles fournies par les fabricants en début d'année, et peuvent donc différer des volumes réellement exportés, elles constituent la source d’informations la plus complète disponible.
La croissance spectaculaire des exportations européennes s’explique principalement par l’interdiction d’une centaine de nouveaux pesticides depuis 2018, et leur ajout subséquent à la liste des substances soumises à la législation sur l’exportation de produits chimiques dangereux. Ceci a provoqué une augmentation « mécanique » des quantités exportées déclarées, au fur et à mesure que l’UE bannissait ces substances de son marché – mais continuait de les exporter vers des pays tiers. Ces pesticides hautement toxiques étaient sans doute déjà exportés auparavant mais n’apparaissaient pas dans les données, car leur utilisation était encore autorisée.
En Suisse, le Conseil fédéral joue la montre
La Suisse exporte aussi des pesticides interdits, mais c'est la plus grande opacité qui règne. En 2020, le Conseil fédéral avait pourtant décidé de durcir la règlementation pour « contrôler de manière plus stricte » ces exportations. Mais la liste des substances soumises à la règlementation helvétique sur l’exportation de produits chimiques dangereux n’a pas été actualisée depuis. Des dizaines de pesticides récemment interdits en Suisse échappent ainsi à tout contrôle et peuvent être librement exportées depuis le territoire helvétique. Maintes fois repoussée, l’actualisation de cette liste devait enfin être réalisée cette année. Cependant, dans ce qui semble être une volonté délibérée de torpiller l’initiative prise par l’ancienne responsable du Département fédéral de l’environnement, Simonetta Sommaruga, les services d’Albert Rösti ont une nouvelle fois repoussé cette mise à jour. On parle désormais d’une proposition qui serait présentée à l’automne l'année prochaine, pour une entrée en vigueur début 2028.
Cinq ans après notre première cartographie inédite, cette nouvelle enquête met en évidence le rôle de premier plan que joue encore le « Vieux Continent » dans la fabrication et l’exportation de pesticides parmi les plus dangereux au monde, alors que Bruxelles semble désormais vouloir se désengager de ses travaux. Le processus initié par la Commission pour mettre fin à l’exportation de pesticides interdits a pris du retard, en raison des fortes pressions du lobby de l’agrochimie. Bruxelles n’a pas tenu son engagement de présenter une proposition avant la fin 2023. Avec le retour de Trump à la Maison-Blanche et la victoire du bloc de droite aux dernières élections européennes, les appels à déréguler se font par ailleurs de plus en plus pressants. Cette réforme sans précédent risque maintenant d’être enterrée, de même que l’ensemble du « Pacte Vert ».
Contactée par Public Eye et Unearthed, la Commission affirme par la voix d’une porte-parole qu’elle «partage les préoccupations concernant les exportations vers des pays tiers de pesticides interdits dans l’UE» et assure qu’elle reste «déterminée à traiter cette question importante». Elle explique qu’une étude d’impact a été lancée en 2023 et déclare étudier actuellement les « options possibles » pour mettre en œuvre son initiative afin d'«assurer que les produits chimiques les plus dangereux interdits dans l'UE ne puissent pas être produits à des fins d'exportation». «Il est primordial de garantir un niveau élevé de protection des personnes et de l'environnement, tant au sein de l'UE qu'à l'échelle mondiale», ajoute-t-elle.
 ©
Shutterstock
©
Shutterstock
Marcos Orellana, rapporteur spécial des Nations Unies sur les produits toxiques et les droits humains, déplore pour sa part « un double standard odieux » qui représente une « une forme d'exploitation moderne dont la connotation raciale ne peut être ignorée ». « Il semble que pour les pays qui produisent et exportent des pesticides interdits, la vie et la santé des populations des pays destinataires ne soient pas aussi importantes que celles de leurs propres citoyens », ajoute-t-il. « Alors que les travailleurs et leurs familles souffrent, les fabricants de pesticides engrangent les profits.»
Poisons « made in Europe »
Notre enquête montre qu’au total, 75 pesticides interdits dans l’UE ont été annoncés à l’exportation en 2024 – contre 41 en 2018. En tête de liste: le dichloropropène (1,3-D), un pesticide utilisé pour contrôler les ravageurs dans la culture de fruits et de légumes. Classé cancérogène probable aux États-Unis, il est interdit dans l’UE depuis 2007 en raison de risques de contamination des eaux souterraines et pour la biodiversité. Plus de 20'000 tonnes de 1,3-D ont été notifiées à l’exportation l’an dernier. Suivent le glufosinate, un herbicide exporté par BASF qui peut provoquer des troubles de la fertilité, et le mancozèbe, un fongicide classé perturbateur endocrinien qui peut nuire à la fertilité et à l'enfant à naître, dont l’utilisation a été interdite dans l’UE en 2020.
L’UE continue aussi d’exporter des milliers de tonnes de néonicotinoïdes, ces insecticides impliqués dans le déclin des pollinisateurs à travers le monde. Ils sont interdits d’utilisation dans les champs européens depuis 2019, en raison de risques « inacceptables » pour les abeilles. La Commission européenne elle-même considère que les néonicotinoïdes constituent une menace si grave pour la biodiversité, la production agricole et la sécurité alimentaire au niveau mondial qu'elle a adopté une loi interdisant l’importation d'aliments contenant des traces de deux de ces substances. Pourtant, chaque année, elle continue d’exporter de grandes quantités de ces mêmes néonicotinoïdes interdits. Nos données montrent que le Bâlois Syngenta et l’Allemand Bayer sont les leaders de ce business toxique des « tueurs d’abeilles » fabriqué en Europe.
Destinations à hauts risques
À qui sont destinées ces exportations de pesticides interdits? Dans la liste des importateurs figurent 93 pays, dont les trois-quarts sont des pays à revenu faible ou intermédiaire. Les agences onusiennes alertent pourtant des risques plus élevés liés à l’utilisation de pesticides dits extrêmement dangereux dans ces pays. Les États-Unis, où la législation est bien plus permissive que dans l’UE, sont le premier importateur, suivi par le Brésil, premier marché mondial des pesticides.
Au menu pour l’ancienne colonie portugaise? Près de 15'000 tonnes de pesticides interdits « made in Europe », au premier rang desquels figure la picoxystrobine, un fongicide utilisé dans les cultures de céréales et de soja, interdite dans l’UE en 2017 en raison d’un potentiel génotoxique et d’un risque élevé pour les organismes aquatiques et les vers de terre.
 ©
Shutterstock
©
Shutterstock
« Nous sommes indignés par l'augmentation des exportations de pesticides dangereux », réagit Alan Tygel, coordinateur de la Campagne brésilienne contre les produits agrotoxiques et pour la vie. « Le fait que les pays européens continuent d'interdire de nouveaux pesticides pour leur usage interne tout en produisant ces substances pour l'exportation souligne bien l'hypocrisie d'un bloc qui prétend pourtant montrer l'exemple. »
Notre enquête montre également que près de 9'000 tonnes de pesticides interdits ont été annoncés à l’exportation vers le continent africain. Premières destinations : le Maroc et l’Afrique du Sud. Pour Kara Mackay, coordinatrice de campagnes pour l’organisation sud-africaine Women on Farms, ce « double standard flagrant révèle la pensée raciste et coloniale dont l’Europe souffre encore ». Elle a un message à faire passer : « envoyer des pesticides interdits en Afrique, ou dans tout autre pays à faible revenu, n’est possible que si l’on considère les personnes qui les utilisent comme inférieures, et donc que l’on ne se soucie pas de leur santé. Cette pratique fait passer le profit avant les êtres humains. En Afrique du Sud, on veut que ça change. Nous en avons assez, et nous en sommes littéralement malades! »
Un business florissant
Avec plus de 33'000 tonnes annoncées à l’exportation en 2024, BASF est de loin le numéro un de ce commerce, suivi de Teleos Ag Solutions, Agria, Corteva Agriscience et Syngenta. Le géant bâlois a notifié l’exportation de près de 9000 tonnes de pesticides interdits depuis l’UE l’an dernier, dont l’immense majorité depuis l’Allemagne.
 ©
Shutterstock
©
Shutterstock
Plus d’un quart de ces volumes concernaient des produits à base de thiaméthoxame, l’un des insecticides néonicotinoïdes « tueurs d’abeilles ». Parmi les principales exportations de la multinationale figurent aussi le propiconazole, un fongicide interdit dans l’UE en 2018 en raison de sa toxicité pour la reproduction et d’un risque de contamination des eaux souterraines, ainsi que le chlorothalonil, un fongicide classé cancérogène qui pollue l’eau potable à vaste échelle en Suisse et en France, mais aussi au Costa Rica, comme nous le révélions dans une précédente enquête.
Confrontée à nos révélations, Syngenta déclare que ses exportations sont « conformes aux exigences strictes de la réglementation européenne en matière de produits chimiques » et qu’elle « respecte la souveraineté et les directives du pays importateur, satisfait à toutes les exigences réglementaires internationales […] et fournit des informations détaillées dans le pays afin de promouvoir une utilisation sûre par les utilisateurs finaux ». Un porte-parole du géant bâlois souligne que «les besoins agricoles varient à travers le monde» et explique que les usines de l'entreprise sont concentrées dans « quelques endroits » afin de garantir que ses produits « répondent aux normes de production rigoureuses et soient de la plus haute qualité ».
Royaume-Uni : du poison estampillé Syngenta
Le géant bâlois de l’agrochimie Syngenta exporte aussi des pesticides interdits depuis le Royaume-Uni. Et les volumes sont massifs. Première exportation? Le diquat, un herbicide interdit dans l’Union européenne en raison de sa toxicité aiguë et d’un « risque élevé » pour les agriculteurs et les personnes résidant aux abords des champs, que Syngenta continue de fabriquer pour l’exportation dans son usine d’Huddersfield. La majorité de ces volumes étaient destinés au Brésil, où les cas d’intoxication d’agriculteurs sont en hausse, comme nous le montrions dans un reportage dans l’État du Paraná.
Syngenta continue également d’expédier des milliers de tonnes du tristement célèbre paraquat, cet herbicide impliqué dans des dizaines de milliers de cas d’empoisonnements à travers le monde. Aux États-Unis, premier pays importateur, le groupe est visé par des plaintes de centaines d’agriculteurs, dont certains sont atteints de la maladie de Parkinson. Ils incriminent le paraquat et reprochent à la multinationale suisse de ne pas les avoir avertis des risques liés à l’utilisation de ce produit.
Au total, plus de 40% des volumes exportés par l’UE ont été notifiés depuis l’Allemagne. Ce pays, qui a vu ses exportations sextupler depuis 2018 pour atteindre 50'000 tonnes l’an dernier, est devenu le principal hub européen pour le commerce de pesticides interdits. Cette évolution est liée à l’interdiction du glufosinate fin 2018, mais aussi à une hausse exponentielle de ses exportations. Elle s’explique également par le fait que Syngenta a transféré une partie de ses activités en Allemagne, en particulier depuis la France, où une loi imposant des restrictions à l’exportation de pesticides interdits est entrée en vigueur en 2022. La Belgique, où un arrêté royal prohibant l'exportation de pesticides interdits est entré en vigueur en mai dernier, était le deuxième plus grand exportateur en 2024, suivi de près par l’Espagne, les Pays-Bas et la Bulgarie.
« Deux poids, deux mesures »
Lors d'une manifestation organisée fin juin à Bruxelles, une coalition de plus de 600 ONG et syndicats, dont Public Eye fait partie, a demandé à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, de tenir sa promesse, en mettant enfin un terme aux exportations de pesticides interdits depuis le sol européen. Les ONG critiquent l’inaction de la Commission et sa politique du « deux poids, deux mesures », qui sapent la crédibilité de l’UE et son leadership mondial en matière de protection contre les produits chimiques dangereux. Elle fait par ailleurs courir « un risque inacceptable » aux communautés dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. La coalition pointe également du doigt un risque pour les consommateurs et consommatrices en Europe, qui se retrouvent exposé·e·s à des résidus de pesticides interdits dans les denrées alimentaires, importées ainsi qu’une « concurrence déloyale » pour les agriculteurs et agricultrices européen·ne·s, à qui l’on interdit d’utiliser ces substances.
 ©
Pesticide Action Network (PAN)
©
Pesticide Action Network (PAN)
Ces déclarations font écho à une lettre adressée en décembre 2024 à la nouvelle commissaire à l'environnement, Jessika Roswall, par le Danemark, l'Autriche, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède, demandant à la Commission d'œuvrer sans tarder en faveur d'une interdiction des exportations de pesticides interdits à l’échelle européenne. « Il est important que nous prenions nos responsabilités au sein de l'UE et que nous montrions que nous ne voulons pas seulement protéger nos propres citoyens, mais aussi donner l'exemple au niveau mondial en ce qui concerne les produits chimiques », a déclaré Magnus Heunicke, ministre de l'environnement du Danemark. « Il s'agit d'une question de responsabilité morale et politique. »
Les géants de l’agrochimie n’ont pas encore gagné la partie.

