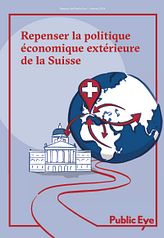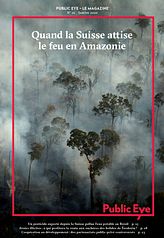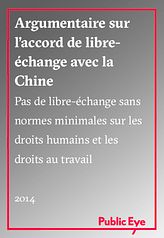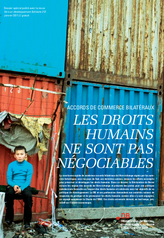Politique commerciale
Contexte
Politique commerciale et droits humains
Plus d'informations
-
Études d'impact sur les droits humains
«Le commerce mondial doit être mis au service des droits humains. Cela signifie que les droits humains doivent servir de cadre à toutes les décisions de politique commerciale». C’est ce qu’exigeait Public Eye il y a plus de dix ans déjà dans sa brochure «Menschen-Rechte Wirtschaft».
Cette exigence est plus que jamais d’actualité. En effet, des conflits entre commerce et droits humains sont encore plus probables dans les accords bilatéraux de libre-échange (ALE), dont les dispositions vont plus loin que celles comprises dans les accords multilatéraux. Ce constat est particulièrement vrai pour les ALE avec des pays présentant des risques aigus de violations des droits économiques, culturels et sociaux.
La réduction massive des droits de douane sur les importations peut ainsi priver les pays du Sud d’importantes sources de revenus dont ils dépendent cruellement pour venir en aide aux plus démunis et aux couches les plus faibles de la population. Le droit à la sécurité sociale, à une alimentation adéquate et suffisante ou à la formation risquent alors d’être bafoués.
Par ailleurs, les revendications récurrentes visant à renforcer la protection des brevets dans les ALE peuvent avoir des conséquences négatives sur le droit à la santé garanti par le droit international (voir à ce sujet la brochure de Public Eye «Les droits humains ne sont pas négociables»).
Analyses préalables d'impact sur les droits humains
Les comités pour les droits humains de l’ONU mettent en garde depuis des années contre les risques de violation des droits humains liés aux ALE. L’ONU a de nouveau demandé à la Suisse de réaliser une évaluation des conséquences potentielles de ses ALE sur les droits humains dans ses pays partenaires.
Les études d’impact sur les droits humains permettent d’anticiper les conséquences possibles des ALE sur les droits humains dans le pays partenaire. Leurs résultats devraient constituer une importante base pour les négociations et servir d’orientation pour la conception de l’ALE. Elles permettent également de faire la lumière sur les processus de négociation souvent peu transparents ainsi que de rendre plus démocratique la négociation d’intérêts conflictuels et de soumettre les décisions à un contrôle public.
C’est pourquoi Public Eye demande depuis des années au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité compétente pour les questions relatives au commerce, d’effectuer de telles études d’impact sur les droits humains – et ce avant que les négociations d’un nouvel ALE ne soient terminées.
Comme le SECO s’est entêtée depuis des années à ne pas réaliser d’analyses préalables d’impact sur les droits humains pour ses ALE, la Commission de gestion du Conseil national a pris les devants et a demandé au Conseil fédéral de réaliser des analyses préalables d’impact sur les droits humains avant de conclure des ALE. Et elle a eu gain de cause : dans sa dernière stratégie économique extérieure, le Conseil fédéral a promis de réaliser de telles analyses « avant d’importants accords économiques ». Public Eye continuera de suivre ces évolutions d’un œil critique et surveillera notamment si les évaluations portent également sur les éventuelles conséquences sur les droits humains.
-
Chapitre durabilité dans les accords de libre-échange
 ©
Brot für alle (BFA)
©
Brot für alle (BFA)
Depuis 2010, les accords de libre-échange (ALE) conclus par la Suisse, pour la plupart sous l’égide de l’AELE, comportent par défaut un chapitre sur le commerce et le développement durable qui comprend des dispositions relatives à la protection de l’environnement et au droit du travail. Entre 2017 et 2020, ce chapitre a été révisé et complété par de nouvelles dispositions essentielles concernant notamment le changement climatique, la biodiversité et la gestion des ressources forestières.
Ces ajouts sont certes louables, mais ils ne changent rien au défaut fondamental du chapitre sur la durabilité : celui-ci n’est pas beaucoup plus qu’une déclaration d’intention car il ne prévoit toujours pas de possibilités de sanctions comme mécanisme de contrôle contraignant. Ce sont justement les dispositions de durabilité qui sont explicitement exclues de l’arbitrage prévu par l’accord. Cela signifie qu’elles ne sont pas juridiquement contraignantes ni justiciables et qu’en cas de différend, la Suisse se repose sur des consultations et un groupe d’expert·e·s.L’Union européenne (UE), quant à elle, a récemment adopté dans ses accords commerciaux une approche basée sur des sanctions pour certaines dispositions relatives à la durabilité comme le changement climatique et les normes de travail. Alors que l’UE se montrait purement «coopérative» jusqu’ici, elle semble avoir pris conscience que seule la possibilité de sanctions permet de réellement faire appliquer ces dispositions.
-
Droits de propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle tels que les brevets, la protection des obtentions végétales ou la protection des marques sont des instruments importants permettant aux inventeurs d’être rémunérés pour le fruit de leur travail. Face à ces instruments se trouve l’intérêt public dans l’utilisation des innovations. Le défi dans l’élaboration des droits de propriété intellectuelle consiste à trouver un équilibre entre ces deux types d’intérêts, privés et publics.
Avec la politique commerciale actuelle, axée sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle, cet équilibre risque d’être perdu. Dans les accords de libre-échange conclus avec des pays en développement et émergents, il est habituel que soient exigés une extension et un renforcement des droits de propriété intellectuelle au profit des pays industrialisés – qui disposent de la plupart des droits de propriété.
La Suisse accepte les violations de droits humains
Dans ce domaine, la Suisse se démarque. Dans le cadre de ses accords de libre-échange avec des pays pauvres, elle exige régulièrement une extension de la protection des droits de propriété intellectuelle. Dans ce contexte, le renforcement des brevets sur les médicaments et des droits de protection des obtentions végétales sur les semences – particulièrement centraux pour la Suisse – s’accompagne du risque de contribuer à des violations de droits humains.
Car des brevets de vaste portée et de durée excessive font augmenter les prix des médicaments. Pour les populations les plus pauvres, ils rendent des médicaments vitaux inabordables. Ce défaut d’accès à de tels traitements constitue une violation du droit humain à la santé.
Une augmentation du niveau de protection sur les semences peut par ailleurs rendre le matériel génétique nécessaire inabordable pour les petits exploitants agricoles. Et il s’agit là encore d’une question de droits humains. Comme Public Eye et ses organisations partenaires l’ont montré dans leur étude d’impact sur les droits humains, un renforcement des droits de protection des obtentions végétales enfreignent l’accès aux semences pour les petits exploitants agricoles et mine ainsi le droit à l’alimentation.
C'est pourquoi Public Eye – en collaboration avec de nombreuses autres organisations – s’oppose régulièrement à l’exigence de renforcement des droits de propriété régulièrement présente dans les accords de libre-échange avec la Suisse. Les droits humains ne sont pas négociables.